 |
ellspacing="0" cellpadding="0"> 

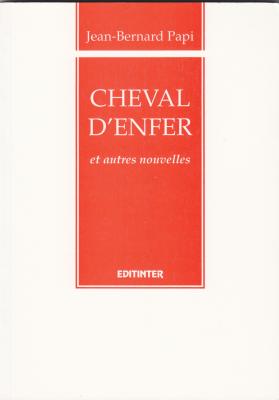
Cheval d'enfer, 1998, (épuisé) le plus dingue des textes en 65 pages. Un pilote de T6 se crash parmi les fellaghas en transportant un aumônier... L'histoire est prenante, pleine de rebonds imprévus, "une nouvelle, mélange de Villier de l'Isle Adam et de Jean Hougron" note un critique.
Une partie du texte de "Cheval d'enfer" a fait l'objet d'une lecture-spectacle composée par Michel Philippe, en Juin 2003 dans le cadre de l'année de l'Algérie intitulée "Mirages et brûlures au soleil d'Algérie" en compagnie de textes d' Eugène Fromentin, Pierre Loti, Tocqueville, Mérimé, Maupassant, Kateb Yacine, Pierre-Henri Simon. Spectacle donné à Rochefort- La Rochelle- Saujon dans le cadre des Escales algériennes.
Une partie du texte de "Cheval d'enfer" a fait l'objet d'une lecture-spectacle composée par Michel Philippe, en Juin 2003 dans le cadre de l'année de l'Algérie intitulée "Mirages et brûlures au soleil d'Algérie" en compagnie de textes d' Eugène Fromentin, Pierre Loti, Tocqueville, Mérimé, Maupassant, Kateb Yacine, Pierre-Henri Simon. Spectacle donné à Rochefort- La Rochelle- Saujon dans le cadre des Escales algériennes.
La guerre d'Algérie a créée ses héros chez les uns et les autres. Ici c'est un pilote français prisonnier d'une bande de fellaghas auprés de qui il va vivre des instants exaltants et pénibles. Deux mondes que tout oppose sauf le désir de vivre. J'offre à lire la totalité de la nouvelle qui a donné son titre à l'ouvrage. Bonne lecture. Et bon voyage en enfer.
Cheval d'enfer.
T6 de l'escadron Argonne

1
Marc arriva dans les premiers jours de mai à Saïda. Une petite ville algérienne accrochée à la montagne et traversée par une route qui conduit au désert. En ce temps-là habitée, en sus des autochtones, par beaucoup de militaires de presque toutes les armes. Deux mois plus tard, il mourait. Sous mes yeux. Une espèce de folie héroïque l'avait poussé à faire le mariol devant la mort, comme un toréador devant le taureau. En quelques jours, j'en avais vu des hommes, et des meilleurs, tomber autour de moi, autant qu'un ancien de Verdun pendant la bataille. En y réfléchissant, j'avais beau me dire que c'était la guerre, il n'empêche. Un vrai massacre. On s'était battu pour me délivrer. Avais-je une quelconque valeur marchande ou politique, voire intellectuelle ? Rien du tout. On appliquait simplement la règle du jeu : j'avais été capturé, il fallait me libérer, question d'honneur. Si quelqu'un me l'avait demandé, j'aurais répondu que je ne valais guère plus qu'une crotte de chien. Et par-dessus le marché, moi, j'avais survécu à tous les mauvais coups ; mais pas le curé, mais pas Marc, et pas non plus le tirailleur et d'autres.
J'avais bénéficié, au cours de ma capture, d'une succession de miracles, le mot n'est pas trop fort. Il fallait se rendre à l'évidence, la providence, le destin, ou, autant l'appeler par son nom, Dieu, m'avait accompagné et protégé. Pourquoi moi ? Une option divine comme ça, un coup de dé, je suppose, une carte tirée du tarot suprême qui m'avait désigné. Il fallait l'admettre aussi, Dieu participait, joyeusement et à sa manière, à la folie des hommes ! Comme un chef lapin primesautier et imprévisible jouant avec sa bande sur une lande, par une nuit de grande lune. À moins que ce soit autre chose que je n'aie pas su voir ou comprendre... Marc avait vingt et un ans à peine. Nous nous portions une amitié de pensionnaires qui avait pris corps autour des heures éblouissantes durant lesquelles nous apprenions le métier compliqué et périlleux de pilote de chasse. À cette époque l'on apprenait par équipe de deux et le tirage au sort, dès le premier jour, nous avait réunis. Il y avait bien aussi la nourriture infecte, les corvées décourageantes et les punitions ineptes qu'endurent habituellement les troufions, mais on s'en foutait. La vraie vie n'était pas au sol, mais en l'air. Nous avions vécu cela sur un aérodrome militaire installé à Cognac en Charente, au beau milieu des vignobles. Il se situait à mi-distance, à une cinquantaine de kilomètres, des villes d'où nous étions originaires. Nous avions vu, dans cette proximité, plus qu'une coïncidence, un présage favorable. Pauvre de nous, quelle sottise que de vouloir jouer les devins !
Je lui écrivais de venir me rejoindre à Saïda depuis que j'y avais atterri moi-même, sept ou huit semaines auparavant. J'avais trouvé la ville conforme à ce que j'imaginais de l'Algérie : poussiéreuse et misérable sur fond de ciel bleu. Je m'étais porté volontaire pour venir en découdre dès que je l'avais pu. C'est à dire, lorsque les moniteurs avaient estimé que je pouvais piloter seul et retrouver mon chemin en utilisant une carte, le compas et ma jugeote. Marc hésitait, se trouvait des tas d'excuses, sa mère, sa soeur etc. Ce ne pouvait être la peur, naturellement. Nous étions pilotes de chasse, sacrebleu ! et les mots pour qualifier ce genre de sensation ne faisaient pas partie de notre vocabulaire ! D'ailleurs, je savais qu'il ne pouvait avoir peur puisque je n'avais jamais rien ressenti de tel. De l'appréhension oui, avant un atterrissage difficile par exemple, mais pas de peur. Après Cognac, il avait été affecté non loin de Paris d'où il accomplissait des missions fastidieuses. Il désespérait même de leur trouver un jour, le plus infime attrait. À sa place, je n'aurais pas hésité longtemps. J'étais allé dans sa famille au moins dix fois. Sa mère et sa soeur se portaient comme vous et moi. Mais, le fait qu'il parte si loin flanquait par terre tout l'édifice sentimental construit autour de lui, avouait-il. Il ajoutait qu'il lui fallait du temps pour les préparer, car elles étaient si faibles. Faibles ? Ce n'était pas mon avis, loin de là.
Il descendait de Paris jusqu'à Saintes, en train, toutes les fins de semaine pour découper, le dimanche à midi, le gigot et la frangipane maison. Mission capitale et incontournable pour un jeune homme qui doit construire sa vie, impossible de s'y soustraire. Elles le suppliaient ; il y avait aussi une pointe à enfoncer, un coup de peinture à donner, une branche à scier dans le jardin, tâches dont elles ne pouvaient venir à bout. Il était l'homme de la maison, le terrassier indispensable certes, mais aussi le fils intelligent et fort en thème. Elles espéraient, par-dessus tout, qu'il finirait par se lasser de l'uniforme et du reste, et qu'il réintégrerait rapidement le bercail. Elles le voyaient plutôt professeur et même normalien. Personnellement, je ne trouvais aucun intérêt à être prof, même normalien. Connaissant mon état d'esprit, sa mère n'avait pas vu d'un très bon oeil mon intrusion dans leur univers sucré et chichiteux. Malgré cela, Marc avait insisté pour que je l'accompagne. Il voulait leur montrer qu'il avait du caractère et que je comptais pour lui, probablement. L'école de pilotage était établie à une portée de fusil de Cognac dont on apercevait les clochers et les toits en montant dans nos avions. Notre point de repère pour retrouver la piste, lorsque nous voulions nous poser, était un pont romain sur une boucle de la Charente. Une rivière lente et paisible comme une vache. Cent fois nous avions suivi son lit bordé de prairies et de peupliers pour gagner la ville où nous étions nés et survoler le quartier où habitait l'une ou l'autre de nos familles. Au moins pour prouver à nos géniteurs, non sans fierté, que nous faisions des progrès en pilotage, pour peu qu'ils aient la curiosité de regarder en l'air ce jour-là.
Pour moi, c'était Angoulême, en amont. Une bonne grosse ville de courants d'air et de marronniers, dressée comme une forteresse sur un éperon rocheux. Balzac l'avait décrite, dans l'un de ses livres le moins ennuyeux, comme une cité partagée entre une aristocratie minable et des bourgeois laborieux et ambitieux. Je n'avais aucune peine à reconnaître de loin mon vieux lycée, bien à plat sur les remparts, solide et engageant comme une prison. Pour ne pas gêner les potaches, et parce que je ne tenais pas à me rappeler au souvenir de certains professeurs, je prenais grand soin à ce que nos trajectoires s'en écartent le plus possible. Lorsque nous projetions d'aller survoler Angoulême, c'était comme de vouloir s'enfoncer dans le continent. Ce n'était pourtant qu'à dix minutes de vol, mais cela me suffisait pour m'imaginer ouvrant une ligne aérienne ou jouant "Pilote de guerre" sur le Niémen ou sur les barrages de la Ruhr. On rêve facilement quand, jeune homme, on doit s'inventer et se fabriquer un destin. Quand papa et maman n'ont pas décidé pour vous. Le mien était de piloter un avion de guerre. C'était prévu depuis mon entrée en sixième, depuis qu'un des premiers chasseurs à réaction avait tracé un sillon de chantilly dans le ciel du lycée. Voler, conquérir et me battre, dans n'importe quelle guerre, même celle des étoiles, pourvu que ça se passe dans le ciel et que ça pète ! J'avais envie de devenir un guerrier, sous-entendu un héros car je n'imaginais pas un guerrier qui ne soit pas héroïque ; c'était comme ça et je ne m'en cachais pas.
J'avais bénéficié, au cours de ma capture, d'une succession de miracles, le mot n'est pas trop fort. Il fallait se rendre à l'évidence, la providence, le destin, ou, autant l'appeler par son nom, Dieu, m'avait accompagné et protégé. Pourquoi moi ? Une option divine comme ça, un coup de dé, je suppose, une carte tirée du tarot suprême qui m'avait désigné. Il fallait l'admettre aussi, Dieu participait, joyeusement et à sa manière, à la folie des hommes ! Comme un chef lapin primesautier et imprévisible jouant avec sa bande sur une lande, par une nuit de grande lune. À moins que ce soit autre chose que je n'aie pas su voir ou comprendre... Marc avait vingt et un ans à peine. Nous nous portions une amitié de pensionnaires qui avait pris corps autour des heures éblouissantes durant lesquelles nous apprenions le métier compliqué et périlleux de pilote de chasse. À cette époque l'on apprenait par équipe de deux et le tirage au sort, dès le premier jour, nous avait réunis. Il y avait bien aussi la nourriture infecte, les corvées décourageantes et les punitions ineptes qu'endurent habituellement les troufions, mais on s'en foutait. La vraie vie n'était pas au sol, mais en l'air. Nous avions vécu cela sur un aérodrome militaire installé à Cognac en Charente, au beau milieu des vignobles. Il se situait à mi-distance, à une cinquantaine de kilomètres, des villes d'où nous étions originaires. Nous avions vu, dans cette proximité, plus qu'une coïncidence, un présage favorable. Pauvre de nous, quelle sottise que de vouloir jouer les devins !
Je lui écrivais de venir me rejoindre à Saïda depuis que j'y avais atterri moi-même, sept ou huit semaines auparavant. J'avais trouvé la ville conforme à ce que j'imaginais de l'Algérie : poussiéreuse et misérable sur fond de ciel bleu. Je m'étais porté volontaire pour venir en découdre dès que je l'avais pu. C'est à dire, lorsque les moniteurs avaient estimé que je pouvais piloter seul et retrouver mon chemin en utilisant une carte, le compas et ma jugeote. Marc hésitait, se trouvait des tas d'excuses, sa mère, sa soeur etc. Ce ne pouvait être la peur, naturellement. Nous étions pilotes de chasse, sacrebleu ! et les mots pour qualifier ce genre de sensation ne faisaient pas partie de notre vocabulaire ! D'ailleurs, je savais qu'il ne pouvait avoir peur puisque je n'avais jamais rien ressenti de tel. De l'appréhension oui, avant un atterrissage difficile par exemple, mais pas de peur. Après Cognac, il avait été affecté non loin de Paris d'où il accomplissait des missions fastidieuses. Il désespérait même de leur trouver un jour, le plus infime attrait. À sa place, je n'aurais pas hésité longtemps. J'étais allé dans sa famille au moins dix fois. Sa mère et sa soeur se portaient comme vous et moi. Mais, le fait qu'il parte si loin flanquait par terre tout l'édifice sentimental construit autour de lui, avouait-il. Il ajoutait qu'il lui fallait du temps pour les préparer, car elles étaient si faibles. Faibles ? Ce n'était pas mon avis, loin de là.
Il descendait de Paris jusqu'à Saintes, en train, toutes les fins de semaine pour découper, le dimanche à midi, le gigot et la frangipane maison. Mission capitale et incontournable pour un jeune homme qui doit construire sa vie, impossible de s'y soustraire. Elles le suppliaient ; il y avait aussi une pointe à enfoncer, un coup de peinture à donner, une branche à scier dans le jardin, tâches dont elles ne pouvaient venir à bout. Il était l'homme de la maison, le terrassier indispensable certes, mais aussi le fils intelligent et fort en thème. Elles espéraient, par-dessus tout, qu'il finirait par se lasser de l'uniforme et du reste, et qu'il réintégrerait rapidement le bercail. Elles le voyaient plutôt professeur et même normalien. Personnellement, je ne trouvais aucun intérêt à être prof, même normalien. Connaissant mon état d'esprit, sa mère n'avait pas vu d'un très bon oeil mon intrusion dans leur univers sucré et chichiteux. Malgré cela, Marc avait insisté pour que je l'accompagne. Il voulait leur montrer qu'il avait du caractère et que je comptais pour lui, probablement. L'école de pilotage était établie à une portée de fusil de Cognac dont on apercevait les clochers et les toits en montant dans nos avions. Notre point de repère pour retrouver la piste, lorsque nous voulions nous poser, était un pont romain sur une boucle de la Charente. Une rivière lente et paisible comme une vache. Cent fois nous avions suivi son lit bordé de prairies et de peupliers pour gagner la ville où nous étions nés et survoler le quartier où habitait l'une ou l'autre de nos familles. Au moins pour prouver à nos géniteurs, non sans fierté, que nous faisions des progrès en pilotage, pour peu qu'ils aient la curiosité de regarder en l'air ce jour-là.
Pour moi, c'était Angoulême, en amont. Une bonne grosse ville de courants d'air et de marronniers, dressée comme une forteresse sur un éperon rocheux. Balzac l'avait décrite, dans l'un de ses livres le moins ennuyeux, comme une cité partagée entre une aristocratie minable et des bourgeois laborieux et ambitieux. Je n'avais aucune peine à reconnaître de loin mon vieux lycée, bien à plat sur les remparts, solide et engageant comme une prison. Pour ne pas gêner les potaches, et parce que je ne tenais pas à me rappeler au souvenir de certains professeurs, je prenais grand soin à ce que nos trajectoires s'en écartent le plus possible. Lorsque nous projetions d'aller survoler Angoulême, c'était comme de vouloir s'enfoncer dans le continent. Ce n'était pourtant qu'à dix minutes de vol, mais cela me suffisait pour m'imaginer ouvrant une ligne aérienne ou jouant "Pilote de guerre" sur le Niémen ou sur les barrages de la Ruhr. On rêve facilement quand, jeune homme, on doit s'inventer et se fabriquer un destin. Quand papa et maman n'ont pas décidé pour vous. Le mien était de piloter un avion de guerre. C'était prévu depuis mon entrée en sixième, depuis qu'un des premiers chasseurs à réaction avait tracé un sillon de chantilly dans le ciel du lycée. Voler, conquérir et me battre, dans n'importe quelle guerre, même celle des étoiles, pourvu que ça se passe dans le ciel et que ça pète ! J'avais envie de devenir un guerrier, sous-entendu un héros car je n'imaginais pas un guerrier qui ne soit pas héroïque ; c'était comme ça et je ne m'en cachais pas.
Marc était né à Saintes, en aval de Cognac. Une ville imprégnée d'eau comme une éponge. Une fois Saintes survolé, il m'entraînait toujours jusqu'à la mer toute proche. Après nous être essayés aux acrobaties, tonneaux et loopings, au-dessus du phare de Cordouan, nous passions, aile dans aile le plus serré possible, très bas au-dessus des plages au risque de nous faire dénoncer par un grincheux. L'idée qu'il puisse y avoir des baigneuses en train d'admirer nos petites voltiges interdites, nous n'avions pas encore suffisamment de métier, lui fouettait le sang. Pour ma part, je le dis tout crûment, je trouvais cela puéril et je me contentais de l'accompagner sans faire de commentaire. On vivait alors dans la hantise d'une troisième guerre mondiale. Un pilote d'avion de chasse, silhouette de jeune costaud sur fond de soleil couchant, était un séducteur et un protecteur en puissance. Du moins pour quelques filles ; celles qui étaient sensibles à ce prestige couillon de l'uniforme et à tout le bataclan clinquant qui l'accompagne. Je crois que Marc en abusait un peu, mais c'était dans sa nature. C'était aussi un garçon silencieux que l'on pouvait croire en permanence en train de brasser des idées compliquées, une sorte de philosophe qui cherchait une explication pour tout et sur tout. Il était cultivé, en tout cas beaucoup plus que moi, et prétendait que le monde devait appartenir aux aventuriers de la science, genre médecin des lépreux, naufragé volontaire comme Bombard ou escaladeur d'Everest. Il plaçait l'aventure loin devant toute autre activité humaine. Cette sorte de profession de foi exaltée ne pouvait que me plaire, même si une bonne part d'illusion et d'utopie agaçantes l'émaillait. Nous estimions, aussi, avoir largement le temps de faire fortune. Le trésor que nous souhaitions amasser, c'étaient les fruits savoureux de la gloire. Chacun à notre manière.
La famille de Marc, depuis plus de cent ans, habitait, au coeur de Saintes, une de ces vastes et anciennes maisons auprès de l'église Saint-Pierre qui sont en réduction des sortes de palais vénitiens. L'église, un édifice cul-de-jatte, laid et calciné par le temps, était facile à repérer du ciel à cause de son clocher coiffé d'une calotte de zinc qui brillait comme une balise. Nous le frôlions de plus en plus près en faisant rugir nos machines. Plusieurs fois, jusqu'à ce que nous soyons sûr qu'un nombre respectable de badauds nous aient vus. Cela tenait du cirque casse-cou plus que d'une démonstration de pilotage, mais nos machines étaient solides et obéissantes. Nous pilotions des appareils américains à hélice, biplaces et monomoteurs, pas très puissants mais très maniables, baptisés T6. T pour training, entraînement, et 6 pour je ne sais trop quoi d'amerloque. Ils ressemblaient, de loin, au Zéro japonais qui avait aplati Pearl Harbor, avec un gros nez rond et une longue verrière sur un habitacle prévu pour le pilote et, assis derrière lui, en tandem, son navigateur ou un passager.
Le père de Marc, bourgeois enrichi dans le cognac, était mort lors de la débâcle de 1940. La mère, devenue veuve de guerre à dix neuf ans avait élevé ses deux enfants sans l'aide de quiconque. C'était une femme belle, je dois l'avouer, bien qu'elle ait plus du double de mon âge. D'une beauté, aurait dit Baloiseau -notre professeur de dessin au lycée-, classique et naturelle. Exactement le spécimen de déesse grecque ou romaine qu'il nous faisait dessiner. J'entends encore d'ici ses commentaires : "Remarquez comme tout en elle est achevé et équilibré, regardez le visage, les seins, le ventre, les fesses, les cuisses, notez les rapports heureux, presque musicaux..." Il était le seul à avoir le droit de tripoter les modèles, ceux en chair et en os, le veinard.
J'aurais pu jurer, devant témoins, qu'elle était tout le contraire d'une coquette. Symboles du chagrin et de la mélancolie qui étaient censés l'habiter depuis son veuvage, je ne la vis jamais autrement affublée que de robes sévères et tristes. Jamais je ne la surpris en négligé ou au saut du lit. Plus austère et sévère qu'une dame caté, elle tirait ses cheveux sombres en chignon, se maquillait très peu et se parfumait à peine. En plus, elle ne me parlait que du bout des lèvres, comme à un nègre, car elle était avec moi distante et autoritaire, comme si elle voulait dresser une barrière de mauvaise humeur entre nous. Ce dont je me contrefichais. Je n'avais aucune envie de lui plaire, bien qu'elle fût désirable bien plus encore qu'une autre.
Je venais de vivre une mésaventure cuisante dont je me sentais encore honteux au-delà de toute mesure. Je ne pouvais m'imaginer caressant, ou même simplement enlaçant une femme, sans qu'aussitôt les remords et les doutes me forcent à faire taire mon imagination. Je me comportais donc avec elle selon une politesse exagérée et raffinée qui me mettait à l'abri de toutes les tentations, même celle de lui sourire. Et puis, me disais-je, patelin et faux-cul, c'est la maman de Marc. Bref, elle m'ignorait et grand bien lui fasse. Pourtant, elle aurait pu, en s'habillant plus guilleret et en se faisant plus gracieuse, se remarier facilement pour peu qu'elle cherche. Mais je la devinais du genre lame d'acier, glacée, tranchante, endurcie, sauf avec son fils naturellement. Ce en quoi je me trompais du tout au tout, comme je m'en apercevrai plus tard.
La soeur de Marc, Mireille, arborait lunettes et appareil dentaire pour redresser je ne sais quoi de tordu dans sa bouche. Elle devait avoir seize ou dix sept ans. Qu'elle soit bien faite, ait des yeux d'un noir exquis et parle couramment le latin et le grec m'importait peu. Je la considérais comme ma propre soeur ; c'est à dire que je ne la regardais qu'à peine. En plus, m'imaginer flirtant avec elle et effleurant de la langue, au cours d'un baiser, son appareillage métallique me soulevait l'estomac. Je n'étais pourtant pas un sauvage. Je savais faire rire par des pitreries et des bons mots et j'aimais offrir des fleurs, ce qui n'est déjà pas si mal.
à suivre,
La famille de Marc, depuis plus de cent ans, habitait, au coeur de Saintes, une de ces vastes et anciennes maisons auprès de l'église Saint-Pierre qui sont en réduction des sortes de palais vénitiens. L'église, un édifice cul-de-jatte, laid et calciné par le temps, était facile à repérer du ciel à cause de son clocher coiffé d'une calotte de zinc qui brillait comme une balise. Nous le frôlions de plus en plus près en faisant rugir nos machines. Plusieurs fois, jusqu'à ce que nous soyons sûr qu'un nombre respectable de badauds nous aient vus. Cela tenait du cirque casse-cou plus que d'une démonstration de pilotage, mais nos machines étaient solides et obéissantes. Nous pilotions des appareils américains à hélice, biplaces et monomoteurs, pas très puissants mais très maniables, baptisés T6. T pour training, entraînement, et 6 pour je ne sais trop quoi d'amerloque. Ils ressemblaient, de loin, au Zéro japonais qui avait aplati Pearl Harbor, avec un gros nez rond et une longue verrière sur un habitacle prévu pour le pilote et, assis derrière lui, en tandem, son navigateur ou un passager.
Le père de Marc, bourgeois enrichi dans le cognac, était mort lors de la débâcle de 1940. La mère, devenue veuve de guerre à dix neuf ans avait élevé ses deux enfants sans l'aide de quiconque. C'était une femme belle, je dois l'avouer, bien qu'elle ait plus du double de mon âge. D'une beauté, aurait dit Baloiseau -notre professeur de dessin au lycée-, classique et naturelle. Exactement le spécimen de déesse grecque ou romaine qu'il nous faisait dessiner. J'entends encore d'ici ses commentaires : "Remarquez comme tout en elle est achevé et équilibré, regardez le visage, les seins, le ventre, les fesses, les cuisses, notez les rapports heureux, presque musicaux..." Il était le seul à avoir le droit de tripoter les modèles, ceux en chair et en os, le veinard.
J'aurais pu jurer, devant témoins, qu'elle était tout le contraire d'une coquette. Symboles du chagrin et de la mélancolie qui étaient censés l'habiter depuis son veuvage, je ne la vis jamais autrement affublée que de robes sévères et tristes. Jamais je ne la surpris en négligé ou au saut du lit. Plus austère et sévère qu'une dame caté, elle tirait ses cheveux sombres en chignon, se maquillait très peu et se parfumait à peine. En plus, elle ne me parlait que du bout des lèvres, comme à un nègre, car elle était avec moi distante et autoritaire, comme si elle voulait dresser une barrière de mauvaise humeur entre nous. Ce dont je me contrefichais. Je n'avais aucune envie de lui plaire, bien qu'elle fût désirable bien plus encore qu'une autre.
Je venais de vivre une mésaventure cuisante dont je me sentais encore honteux au-delà de toute mesure. Je ne pouvais m'imaginer caressant, ou même simplement enlaçant une femme, sans qu'aussitôt les remords et les doutes me forcent à faire taire mon imagination. Je me comportais donc avec elle selon une politesse exagérée et raffinée qui me mettait à l'abri de toutes les tentations, même celle de lui sourire. Et puis, me disais-je, patelin et faux-cul, c'est la maman de Marc. Bref, elle m'ignorait et grand bien lui fasse. Pourtant, elle aurait pu, en s'habillant plus guilleret et en se faisant plus gracieuse, se remarier facilement pour peu qu'elle cherche. Mais je la devinais du genre lame d'acier, glacée, tranchante, endurcie, sauf avec son fils naturellement. Ce en quoi je me trompais du tout au tout, comme je m'en apercevrai plus tard.
La soeur de Marc, Mireille, arborait lunettes et appareil dentaire pour redresser je ne sais quoi de tordu dans sa bouche. Elle devait avoir seize ou dix sept ans. Qu'elle soit bien faite, ait des yeux d'un noir exquis et parle couramment le latin et le grec m'importait peu. Je la considérais comme ma propre soeur ; c'est à dire que je ne la regardais qu'à peine. En plus, m'imaginer flirtant avec elle et effleurant de la langue, au cours d'un baiser, son appareillage métallique me soulevait l'estomac. Je n'étais pourtant pas un sauvage. Je savais faire rire par des pitreries et des bons mots et j'aimais offrir des fleurs, ce qui n'est déjà pas si mal.
à suivre,