Et vive la Révolution !
2001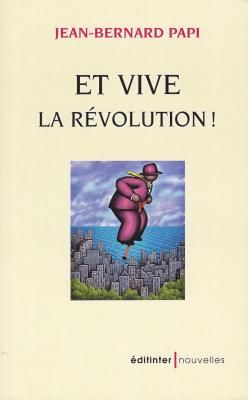
12 nouvelles, dont l'une donne le titre à ce recueil. Toutes, à divers titres traitent de l'utopie sous toutes ses formes. Et vive la révolution (A lire ci-dessous) ou le retour à l'âge d'or 90 pages, 2001. 170 pages 15,24€. Epuisé chez Editinter .
Quelques critiques :
Et vive la révolution Une longue nouvelle éponyme entraînant dans son sillage une dizaine de textes courts. Cette fois c'est dans ces derniers que l'auteur nous a semblé déployer le mieux son talent : un art consommé de la comparaison qui tue (on pense à François Reynaert, féroce chroniqueur du Nouvel Obs) un humour décalé à la Pierre Desproges, un sens de la construction aboutissant implacablement à la chute pourtant toujours surprenante comme chez Buzzati. Une vision très noire d'un XXIe siècle hélas trop plausible. B.N. Nouvelle Donne n°25.
- Et vive la révolution Ses héros ne sont pas sans rappeler les personnages de Jacques Sternberg auteur mieux (re)connu pour qui la nouvelle non plus n'était pas un genre mineur. L'univers de J-B Papi est comme un film de Fellini, même s’il fait de l'œil à Buñuel, qui ne se raconte pas mais dont chaque plan est l'élément d'un puzzle qu'on ne peut lâcher avant de l'avoir achevé. Christian Grené Sud-Ouest du 9/05/2001

Et vive la révolution !

N. était de retour dans sa ville. Il pensait comme ça, par habitude, « ma ville », une mauvaise habitude selon lui. Ce possessif l’irritait, autant que le surnom idiot que les médias lui donnaient dans le temps, la perle blanche, en raison des trois ou quatre monuments près du fleuve recouverts d’une sorte de marbre blanc. Ma ville ! Une ville pareille, merci bien du cadeau, avec son passé de garce au cœur sec qui en voudrait ? Quand il y habitait, la vie n’y était facile que si on avait de l’argent, et beaucoup. De toute façon, aujourd’hui il voulait ne rien posséder, au sens propre comme au figuré, et il trouvait stupide cette façon qu’avaient les gens de s’approprier de vagues entités : ma ville, mes relations, mon compte en banque... Le pire, c’était : ma femme, mes gosses, mon fauteuil etc. La propriété privée avait de beaux jours devant elle.
L’image de son père et de sa mère lui traversa l’esprit. Où étaient-ils enterrés ? L’administration de la prison n’en savait rien. Il eut un mouvement de colère, puis soupira. Il préférait ne plus penser à la taule. C’est tes oignons mon garçon, lui avait répondu un gardien un jour, ils doivent être quelque part dans un cimetière de la ville où ils sont morts, on ne peut pas t’en dire plus. De cette ville justement, il n’avait en mémoire que peu d’images bien qu’il y ait vécu jusqu’à sa vingtième année. Des images le plus souvent brouillées, confuses, mélangées à d’autres. Le fil de ses souvenirs, quand il essayait de reconstituer son passé se rompait souvent, non qu’il soit amnésique, mais c’était loin et tant de choses plus importantes s’étaient passées depuis qui avaient recouvert de cendres sa mémoire. A commencer par un séjour en prison qui venait à peine de se terminer.
Quelques images surnageaient quand même. Des sortes de photographies vieillottes dont les couleurs lui semblaient sales et lessivées, le Grand-Palais, le Jardin d’hiver avec ses cygnes et sa gigantesque serre, la cathédrale gothique de marbre blanc au bord du fleuve, une tour toute blanche elle aussi. Il se souvenait de quelques rues et de deux ou trois endroits qu’il aimait fréquenter, dont une salle de jeux où il allait draguer les lycéennes et plusieurs bars. Une pincée de visages flous surgissaient également. Des individus qui avaient dû s’empresser de l’oublier ; en vingt ans...
Par contre, ce dont il se souvenait parfaitement c’était les péripéties de son arrestation et le procès qui avait suivi.
Il avait vécu jusqu’alors plutôt heureux. Fils unique, une famille aisée, étudiant appliqué, son avenir ne pouvait être que tout tracé, harmonieux, comme pour la grande majorité de ses copains d’étude. C’était avant qu’on ne le conduise dans le pénitencier spécial pour individus dangereux et fortes têtes, à l’autre bout du pays. Un pénitencier isolé dans le désert rural, dans cette suite de plateaux incultes, de vallées marécageuses et de forêts épaisses qui séparaient les six métropoles du sud.
– T’en fais pas mon garçon. Faire de la prison dans le monde d’aujourd’hui, c’est courant. Aussi commun que de dîner au restaurant ou de se faire virer de son boulot, lui avait dit l’éducateur abondamment barbu et chevelu venu lui rendre visite le lendemain de son incarcération. C’est une réalité qu’il faut s’enfoncer dans le crâne quand on entre ici, ça empêche de gamberger. Ici, il n’y a que des gars qui ont pas eu de pot. Ricanement de l’éducateur. Et puis, la prison a mauvaise réputation c’est vrai, mais elle a aussi quelques bons côtés. Par exemple, tu es tranquille, personne ne vient t’embêter pour tes impôts. On est entre hommes et les relations sont simples. On est unis comme des frères ; on est les membres d’une même famille, matons, administratifs et taulards... On a aussi nos petites combines et si on a un peu d’argent on peut se procurer ce que l’on veut.
– Vous parlez comme si d’écoper la perpétuité était un évènement intéressant et avantageux ! Des vacances ou je ne sais trop quoi de sympathique, avait riposté N. Cet endroit n’a rien d’un centre récréatif ou d’une maison de repos, même pour l’imbécile heureux que vous semblez croire que je suis !
L’éducateur avait eu un petit geste effrayé et s’était confondu en excuses. C’était le même discours pour tout le monde et avec certains ça marchait à fond. De vraies brebis stupides. Puis, puisqu’il était payé pour ça, il avait scrupuleusement écouté le récit de l’arrestation de N. et émis les exclamations scandalisées et les grognements apitoyés aux bons moments. Cependant, on le remarquait dans son regard et dans l’affaissement de son visage, sans en croire un seul mot. Les criminels affabulent, semblait-il penser, mais il faut crever l’abcès et laisser s’écouler le pus.
Il avait raison en un sens et cela avait fait du bien à N. de mettre son histoire à plat. Il avait pu, en compagnie de l’éducateur, l’examiner avec l’œil froid d’un technicien, par l’extérieur, comme un cas d’école. Au cours des rencontres qui avaient suivi, ils avaient étudié l’éventualité, hautement improbable malgré tout, qu’il puisse sortir un jour à la suite d’une remise de peine. Et puis N. n’avait pu se retenir, il avait affirmé qu’il se vengerait de ceux qui l’avaient expédié là.
Il l’avait fait d’une voix tranquille et réfléchie, sans émotion comme s’il était d’avance sûr de son coup. L’éducateur l’avait écouté stupéfait, puis la main sur le cœur et la voix frémissante d’indignation il s’était élevé contre de tels propos. Il fallait subir et fermer son caquet, en taule plus encore que dans la vie courante. Il devait respecter les décisions de la cour.
– Pourquoi pas du roi, avait grimacé N.
– De la justice si vous voulez, ne soyez pas idiot. Et puis, c’est dégradant cette idée de vengeance, vous qui êtes si bien élevé.
– Mais nom d’un chien, puisque je suis innocent et que je paie pour un autre !
– Dans ce cas, la docilité n’en a que plus de prix. La soumission à l’inéluctable destinée, même mauvaise, il n’y a rien de plus noble chez l’homme... Vous devenez un martyr, c’est beau un martyr.
N. à cet instant, s’était rendu compte que ce chevelu avec sa voix suave et étudiée, ses sophismes de femme de ménage, lui faisait perdre son temps. Sans parler de cette manie qu’il avait de vous caresser la joue ou de vous pincer la cuisse à tout bout de champ. Il l’avait fichu dehors, choisissant, ce jour-là et pour longtemps, la seule compagnie des livres et des quelques insectes, mille-pattes et mouches, qui galopaient sur les murs et le plafond de sa cellule. Plus tard il avait appris que l’éducateur était aussi le mouchard du directeur de la prison.
Il avait donc vécu vingt ans seul, privé, pratiquement, de tous rapports avec les autres détenus ; sur ordre du directeur qui craignait qu’il ne s’évade ou fasse un mauvais coup avec d’autres cinglés comme lui. Il n’avait le droit d’adresser la parole qu’aux gardiens et à quelques civils employés dans la maison, comme le médecin, le bibliothécaire et deux ou trois enseignants de travaux manuels, et encore il fallait que ce soit dans le cadre strict du travail ou en application du règlement. Le reste du temps il était seul, partout, dans la salle de gymnastique, dans la bibliothèque ou pendant les repas.
Pas de radio, pas de télé, sauf la télé interne qui ne diffusait que des futilités sans intérêt. A sa grande surprise, il s’était rapidement fait à cette existence d’ermite. Parfois quelques visites venaient couper ses journées, son père et sa mère à qui il n’avait rien à dire et qu’il écoutait parler, son avocat qui faisait semblant de se démener, quelques journalistes menant une sempiternelle enquête sur les prisons. Il avait accepté de bon cœur de travailler. Il réparait les livres de la bibliothèque, bouclé dans un petit réduit ensoleillé. Par la fenêtre il voyait le verger du pénitencier et pouvait lire sur les arbres le passage des saisons.
Il ne manquait pas de travail. La bibliothèque regorgeait de bouquins et le bibliothécaire n’était pas un mauvais cheval. C’était un civil taciturne avec une tête tonsurée et grise de vieux bénédictin qui l’observait à la dérobée, craignant sans doute le pire d’un individu réputé dangereux, mais qui l’orientait gentiment dans le choix de ses lectures. Comme ça, à bouquiner, à faire de la gymnastique et à travailler, le temps était passé plutôt rapidement. Cependant, il n’avait jamais cessé, un seul instant, de penser à sa vengeance. C’était cette pensée qui maintenait, avec une opiniâtreté sans faille, un lien fort avec l’extérieur. Sans elle, il aurait basculé depuis longtemps dans une apathie narcissique, n’ayant d’autre désir qu’une choppe de bière fraîche à la fin de la journée.
La première voix courtoise et un tant soit peu chaleureuse qu’il entendit, après avoir signé son bulletin de levée d’écrou, fut celle du chauffeur de l’autobus qui attendait à quelques pas de la prison, sur la place, devant ce qui devait être les logements des gardiens et de leurs familles. La voix seulement, car il n’avait pas vu l’homme abrité dans une cabine blindée. Lorsqu’il avait gagné son siège, les quelques voyageurs déjà assis n’avaient même pas levé la tête.
Il s’était installé près d’une fenêtre, histoire de se familiariser avec le paysage. Le bus était d’un modèle qu’il ne connaissait pas, un engin puissant avec une carrosserie anguleuse en acier épais d’un doigt, certainement très récent. Pour ce qu’il en avait à faire, il aurait pu dater de Mathusalem et bâti en carton bouilli. Il était heureux de quitter la prison. Cependant il se sentait dans la peau de quelqu’un qui se rend à un rendez-vous important et risqué. Il s’appuya au dossier et ferma les yeux.
« Avec l’accélération exponentielle du progrès tout changeait si vite qu’on en avait le tournis ». C’était une phrase prononcée par le héros d’un bouquin qu’il avait lu la veille, le dernier qu’il ait emprunté à la bibliothèque. La phrase lui revenait en mémoire sans crier gare. Un dessin montrait ce qu’était une exponentielle, elle tendait rapidement vers l’infini sans jamais l’atteindre, expliquait-on dessous. Un progrès infini, se surprit-il à penser pendant que le bus démarrait, à quoi cela peut-il bien ressembler ? Cela n’a aucun sens.
Le bus s’engagea d’abord sur une route rectiligne entre des haies de hauts pins puis il enjamba, par un pont de métal qui vibrait, une vallée de rochers gris où coulait un étroit torrent. De temps en temps, il croisait d’autres véhicules, des autos qu’on avait à peine le temps d’apercevoir. Au bout d’une bonne heure passée à traverser des forêts et d’immenses étendues de landes, il pénétra dans une ville lumineuse, toute blanche et rose. Les habitants, tous beaux, souriants et bien habillés, les saluaient d’un petit geste du bras. N. leur rendit leur salut et quelques passagers haussèrent les épaules en riant sous cape. Il ne s’en aperçut pas et continua, imperturbable, de remercier d’un hochement de tête ou d’un petit mouvement de la main ces sympathiques citadins.
Des pavillons confortables et fraîchement peints, des piscines à demi masquées par des haies d’hortensias, des potagers défilaient maintenant sous ses yeux. Un parcours de golf, avec quelques joueurs sur le fairway, suivit le bord de la route pendant quelques minutes. Un marché de fleurs en plein air obligea l’autobus à ralentir.
Finalement, se dit N., le fameux progrès, exponentiel ou pas, était plutôt plaisant et rassurant. Un homme, maigre et le visage déformé par des tics, vint s’asseoir à côté de lui et en quelques mots, avec un petit rire désabusé et triste, lui expliqua que ce qu’il voyait n’était qu’un paysage fictif destiné à tranquilliser les voyageurs. Un écran de télévision alimenté par une bande vidéo en continu. On avait installé cette saleté sur les bus depuis dix ans au moins.
- Dehors, c’est hideux. Et ça devient un peu plus repoussant chaque jour. Il faudrait en mettre un sacré coup tous ensemble pour en faire quelque chose qui ressemble à ça... Mais qui le veut vraiment, et qui sait même aujourd’hui ce que beau veut dire ? avait-il soupiré avant de se lever pour descendre à l’arrêt suivant.
N. en était resté comme deux ronds de flan, puis le bus était entré dans la gare. Une vraie cette fois, annoncée par la voix tranquille du conducteur. N. était descendu. Il avait arpenté une succession de quais déserts défoncés d’ornières profondes, couverts de détritus et de débris de verre tombés des verrières qui ne tenaient plus en l’air que par deux ou trois consoles tordues et rouillées, pour trouver le train à très grande vitesse qui devait le mener jusqu’à « la » ville. Lequel, selon un employé perché sur une échelle qui semblait vouloir démonter une grosse horloge, avait plus d’une heure de retard aujourd’hui.
Une fois dans le train N. avait constaté que les hublots étaient identiques à ceux du bus. Dès qu’il s’ébranla, ils affichèrent simultanément le même paysage idyllique. N. regarda donc, comme s’il s’agissait d’un documentaire destiné aux attardés de son espèce, les jolies maisonnettes, les prairies herbeuses, les haies sauvages et fleuries qui défilaient. Il vit aussi des troupeaux de vaches et de moutons, et, sur l’horizon, d’archaïques clochers pointus, dentelés comme des râpes à fromage qui crevaient le ciel limpide. Un ciel comme on en trouvait en avril au-dessus du verger ou de la cour de la prison. Ces panoramas lui rappelaient de lointaines vacances. Il avait à cette époque une douzaine d’années, guère plus. Il avait campé avec des copains près d’un antique bourg dont il ne restait que l’arche d’un pont de pierre, une rivière envahie d’herbes, un clocher en grande partie effondré et quelques pans de murs encombrés d’arbustes sauvages et de ronces. Ils y faisaient des fouilles, des fouilles légales et bien payées, pour le compte d’un brocanteur. Car l'ancienne civilisation agricole avait été engloutie, telle une Atlantide, dans un océan de maquis et de broussailles après être tombée en désuétude. On produisait différemment et il ne restait de cette époque qu’un tas de vieilleries rouillées dans les vitrines des musées. Les citadins dans leurs théâtres, N. se souvenait d’y être allé très souvent au temps de sa jeunesse, applaudissaient aux mises en scènes de ce passé au travers de pièces dont le mérite résidait surtout dans l’extrême simplicité des dialogues et l’absence d’action... On faisait aussi du théâtre à partir de crimes, d’accidents reconstitués ou de procès intéressants.
Il se demanda si on avait fait une pièce avec son propre procès. Sans doute que oui.
à suivre,